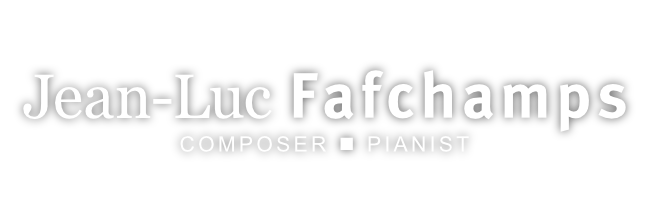La Monnaie de Bruxelles propose Is this the end #2 ?, « Here’s the woman ! » deuxième volet du « pop-requiem » conçu par Jean-Luc Fafchamps sur un livret anglais d’Eric Brucher et une mise en scène et un concept filmique d’Ingrid von Wantoch-Rekowski.
Bien entendu, la vision préalable, repostée en ligne par La Monnaie sur son site, du premier « épisode », « Dead little girl » destiné au streaming, à l’époque incertaine des confinements de l’automne 2020, peut aider à la compréhension de l’action de ce deuxième « acte ». Mais par sa puissance suggestive ce nouveau volet, peut être visualisé pour lui-même, sans introduction préalable : le livret est basé sur un même canevas mais vécu cette fois au travers d’un autre personnage : The Woman, une diva à la recherche de l’absolu par delà la vie et la mort, dont on apprend par le défilé d’incessantes breaking news, qu’elle fut frappée d’un violent malaise dû au surmenage et happée dans l’univers des limbes par leur porte d’entrée que constituerait selon le livret l’Opéra de La Monnaie !
La première partie « Dead Little Girl » était donc centrée sur l’adolescente rebelle et révoltée contre l’injustice de son sort (incarnée par la stratosphérique et magistralement exacerbée colorature Sarah Defrise, plus ponctuellement présente cette fois) frappée alors, apprend-on cette fois, par le voltage trop puissant d’un logiciel immersif lors d’une rave party. « Here’s the woman » creuse davantage l’aspiration à la lumière éternelle et à un amour immatériel de cette femme artiste incarnée par une très émouvante et idéale Albane Carrère, à la voix chaude profonde et ronde, en parfaite connivence dramatique et lyrique avec le rôle. The Man – toujours campé dans un tout autre registre vocal par le chanteur de jazz-rock Amaury Massion « Lylac » – figure centrale du futur troisième opéra – semble plus encore ici, par bribes, chercher désespérément la femme qu’il aimait, ralenti dans ses mouvements, sa pensée et son débit, par la froideur ressentie, et les pannes d’électricité du système de cryogénisation.
Ce second volet tient du semi-direct : l’orgue (celui de Notre–Dame du Sablon d’une subtilité ductile et d’une puissance térébrante) et le petit ensemble de chambre et les chœurs ont été préenregistrés et spatialisés avec parfois de légers effets de « surround » très cinématographiques. Seules la plupart des interventions des trois solistes du chant sont en direct. Mais leur présence scénique dialogue avec leur propre image quasi holographique. Car scéniquement c’est un dialogue virtuose entre vidéos projetées sur supports toilés translucides, portés par un écran-polyptique imité des retables de la Renaissance et acteurs/chanteurs réellement présents, tantôt évanescents derrière ces toiles translucides, tantôt plongés en pleine lumière dans des teintes rubicondes ou mordorées, dans une collision d’imageries mêlant référence à l’ancienne peinture flamande et aux films ou « comics » d’anticipation. Le tout est relevé par les splendides costumes quasi baroques signés Régine Becker.
Si le déroulement du livret peut, par moment, faire penser à une parodie théâtrale d’un requiem religieux (Introit, Kyrie, Lux aeterna), si par leur rôle, les chœurs spatialisés, à la fois commentent et participent à l’action, le ressort dramatique principal du récit naît de l’aspiration de The Woman à une sorte de félicité lumineuse éternelle barrée par les réminiscences d’une vie terrestre pleine de turpitudes et diverses épreuves dans l’Au-delà, tenant quasi de l’Enfer. Ce même si elle prétend, munie d’une impressionnante épée, avoir pris le dessus de ses passions terrestres.
Bloquée par la suite dans une espèce de purgatoire, elle est inquiétée par un chœur condamnant son égocentrisme latent, puis plus loin par un carnaval de monstres : impressionnant défilé vidéo de trolls, gobelins ou harpies auxquels se mêlent minotaure, sphinx, spectres de Dante ou de Jim Morrison (this is the end, chantaient les Doors), voire même, plus avant, des images 3D de quelques musiciens d’orchestre et même le chef d’orchestre Ouri Bronchti qui s’est prêté malicieusement au jeu.
Mais surtout, par sa rencontre dans une « geste de l’amour physique », la Femme-artiste prend sous sa protection platonique et idéalisée, en un somptueux duo néo-tonal (peut-être le sommet d’intensité lyrique de la partition) l’adolescente, laquelle, toujours vierge, ne rêvant que de relations érotiques intimes, fussent-elles lesbiennes. Un duo épique et transcendant dont la conclusion est longtemps différée, après plusieurs scènes cauchemardesques sur le chemin de l’amour éternel, dans une symphonie de rouges évoquant l’ardent désir d’absolu, peu avant la conclusion de l’œuvre.
Pour sa partition, Jean-Luc Fafchamps maîtrise un impressionnant maëlström sonore, brassant, avec une cohérence dramatique étourdissante, les références d’un polystylisme déconcertant. Depuis le prélude d’orgue augural (qu’il mime lui-même sur un clavier imaginaire, dans une tenue tenant à la fois du croque-mort et du magicien), que l’on pourrait croire issu du Livre du Saint-Sacrement de Messiaen, aux réminiscences modales sises dans la banlieue franco-flamande lors des énoncés rituels choraux, des chansons de geste moyenâgeuses aux duos féminins les plus érotisés de la littérature opératique, jusqu’au rock le plus noisy ou au rythme obsédant de la musique électro-techno lors de l’évocation de la rave–party fatale à l’adolescente. Ailleurs ce sont les songs plutôt bluesy confiés à The man voisinant avec les percussions rituelles japonaises (les taïkos) ou berbères (les bendirs) ponctuant les moments plus rituels.
La réalisation technique du spectacle s’avère très léchée, tant sur le plan d’une technique vidéo très pointue, que d’un design sonore redoutablement efficace. Certes, il s’agira de jauger l’œuvre dans sa globalité une fois la trilogie complétée, mais d’ores et déjà voici, avec ce second volet une création subjuguante par sa puissance d’évocation d’expériences limites, telles que décrites par des humains « revenus » à la vie après une situation de mort quasi imminente. Les chœurs, préparés efficacement par Alberto Moro et le petit ensemble orchestral (à un instrumentiste par partie), préenregistrés, sont dirigés de main de maître par le jeune chef israélien Ouri Brochti, lequel avait déjà assumé courageusement la création et les représentation de Dead little girl voici dix-huit mois, au surlendemain du décès inopiné, juste à l’orée de la générale, du regretté Patrick Davin, de cette production au titre sinistrement prémonitoire.
Benedict Hévry, 27 april 2022