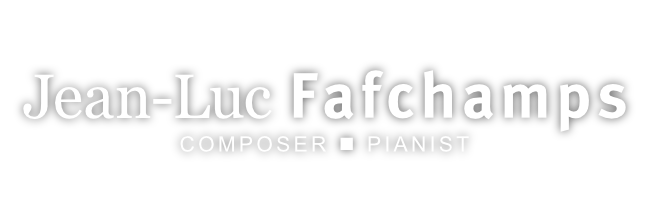Quelques réflexions sur la notion de musique moderne (?). Lorsqu’en 2002, nous avons fondé le Forum des Compositeurs pour le redéploiement du “métier” de compositeur dans notre belle Fédération Wallonie-Bruxelles, j’ai ressenti le besoin de tenter de définir ce que nous voulions défendre, ce que nous espérions, ce qu’était la spécificité de notre expérience, par rapport à celle de nos aînés et à l’héritage problématique qu’ils nous avaient laissé. Je ne crois pas avoir emporté l’adhésion de tous mes collègues du Forum avec ce texte: il est donc simplement un témoignage de ce que je m’étais imaginé que nous partagions…
Hier
Dans la relative ignorance de ma jeunesse, j’imaginais des univers sonores ne devant rien à mes pères et réservant à mes amis des sensations inouïes. Je me voyais rompre avec les vieux fantasmes et les atmosphères poussiéreuses pour partir à la conquête d’un total renouveau: rien de moins! Évidemment à mesure que mon enthousiasme se mâtinait d’un peu de culture, je percevais mieux qui étaient mes pères (bien moins anciens et dépassés que je ne l’avais cru d’abord), et, à la lueur de leur discours avant-gardiste, mon énergie se teintait de perplexité. Rompre : bien volontiers, mais comment rompre avec une idéologie de la rupture ? Puisque la révolution permanente était devenue la règle, comment échapper à l’académisme de cette règle là ? Quelle jeunesse nous laissaient nos anciens ?
Certes, je dévorais avec boulimie les musiques nouvelles, et je découvrais à quel point ces mondes sonores que j’avais rêvés étaient là , à ma portée. Mais, en revanche, le discours, souvent brillant, qui gravitait autour de ces réalisations me stupéfiait. J’étais chaque jour plus atterré par les raisons publiques qu’affichaient – ou avaient affichés – les aînés pour légitimer leur prétendue table rase. Il n’était question, à mes yeux, que de devoir, d’obligation morale et d’une nécessité historique qu’en toute objectivité je ne pouvais trouver que futile ou illusoire, et jamais du plaisir de la découverte qui me semblait être le seul moteur concevable, dans un monde où la scission entre l’artistique, le politique et le religieux était définitivement consommée.
Si je partageais la répulsion de mes aînés à rester assis, je percevais aussi qu’ils n’avaient pu se dresser que par la force d’un certain puritanisme. Ce qu’ils reprochaient à Stravinsky, Shostakovitch ou Britten, ce n’était pas de rabâcher des jouissances connues (ce qui pouvait ouvrir un débat), mais d’être trop peu édifiants. Et j’entendais avec amusement, concernant les objects reconnus : « les oreilles ne sont pas prêtes, mais bientôt le public, habitué, saura apprécier la nouvelle musique ». Il me semblait à moi, que si le plaisir n’entrait jamais en ligne de compte dans la définition des nouveaux enjeux, il y avait peu de raison que quiconque de sensé trouvât la moindre motivation à s’y astreindre, et, plus fondamentalement, que si la rupture était une valeur en soi, il eût du paraître vertigineusement contradictoire qu’on pût espérer que le public s’y habituât ! On eût dû au moins être cohérent avec l’élitisme irréductible de cette idéologie… Mais rien n’y faisait : il fallait que l’Histoire, même future et hypothétique, accrédite la révolution.
En fait, cette fascination pour la relecture orientée – et à rebours – de l’Histoire me semblait être l’héritage le plus discutable du dernier romantisme et elle constituait pourtant l’outil critique le plus indétrônable d’une esthétique qui prétendait le renier totalement. Aussi loin que je cherchais dans le passé un exemple, une rupture indiscutable, bouleversante, qui aurait pu justifier la conviction avec laquelle on s’en remettait à la révolution permanente, je ne trouvais que des aménagements, souvent opportuns, parfois prophétiques, mais toujours enracinés – avec quelques distances, bien sûr – dans une tradition. Par ailleurs, si je constatais dans la musique écrite d’alors une véritable foison de sonorités et de styles richement différenciés, mis au point, jusqu’à leurs plus infimes conséquences, dans l’atmosphère rare et fragile d’un respect incommensurable pour le passé (car on n’envisage de rompre avec le passé que pour mieux en attendre le verdict), les ruptures tant commentées n’y portaient, me semblait-il, que sur des points de détail de plus en plus ténus. Et pour cause : à force de vouloir rompre quotidiennement avec ce qui se faisait hier, on avait fini par tourner en rond, à quelques détails d’exécution près, détails souvent appréciables, mais dont le très faible pouvoir explosif mettait dangereusement en relief l’insupportable dichotomie entre le désormais incontournable discours avant-gardiste et la réalité de la pratique.
Systématisme
 A ce discours vieillissant sur l’exigence du neuf, s’adjoignait un respect immodéré pour les systèmes, et pour toute logique extérieure destinée à doter la création musicale d’une aura de scientificité, totalement coupée de l’impression réelle que produisaient les nouveaux développements du timbre et de la texture musicale. Alors que le timbre – la dimension du son la plus difficile à percevoir comme résultat d’une logique déterministe – constituait principalement une expérience auditive fusionnelle et un peu passive, l’idée ressassée – et d’ailleurs pas tellement par les acteurs de cette évolution – que ce résultat ne pouvait être atteint que par des opérations systémiques très élaborées, qu’il convenait d’apprécier activement, avait de quoi rendre schizophrène.
A ce discours vieillissant sur l’exigence du neuf, s’adjoignait un respect immodéré pour les systèmes, et pour toute logique extérieure destinée à doter la création musicale d’une aura de scientificité, totalement coupée de l’impression réelle que produisaient les nouveaux développements du timbre et de la texture musicale. Alors que le timbre – la dimension du son la plus difficile à percevoir comme résultat d’une logique déterministe – constituait principalement une expérience auditive fusionnelle et un peu passive, l’idée ressassée – et d’ailleurs pas tellement par les acteurs de cette évolution – que ce résultat ne pouvait être atteint que par des opérations systémiques très élaborées, qu’il convenait d’apprécier activement, avait de quoi rendre schizophrène.
Or, personnellement, j’avais du mal avec les systèmes globalisants : aussi compliqués soient-ils, je trouvais qu’ils produisaient des résultats trop simples ou trop univoques. Je me passais Schoenberg en boucle, et je ne pouvais m’empêcher de trouver plus convaincantes les œuvres où il découvrait la liberté de l’atonalité que celles où il inventait le système du dodécaphonisme. Et bien que conscient de la nécessité de l’exploitation des combinatoires dans la relative omni-directionnalité de l’échelle chromatique, j’avais l’intuition que cela ne dispensait pas, somme toute, d’une part non négligeable de complexité supplémentaire. Debussy, Berg ou Bartok me semblaient en donner des exemples plus séduisants – ou plus fertiles – que Webern ou les Structures de Boulez. Car la complexité – c’est-à -dire l’opportunité d’un plaisir durable – n’est presque jamais le résultat de la mise en œuvre d’une systémique unique : elle appelle la mise en relation de réalités contradictoires (harmonie – contrepoint, mélodie – timbre, chromatisme – polarité, sérialisme – plan d’ensemble,…) dont les perturbations mutuelles ménagent une zone d’imprévisibilité nécessaire à l’intérêt du discours. (C’est d’ailleurs un acte de mauvaise fois fréquent que de disqualifier une démarche stylistique en ne voyant qu’une preuve d’incohérence dans les contradictions qu’elle développe en vue de favoriser une nécessaire complexité.)
Contournement
Partout où je cherchais, parmi les grands pionniers du XXe, l’attitude de rupture et de systématisme dont on me disait qu’elle était l’arché de notre modernité, là où je scrutais les signes d’un destin hégélien, je ne trouvais donc qu’un jeu, d’une riche ambiguïté, mi-opportuniste, mi-subversive, avec la tradition. Et, en fait, cela me réjouissait : rompre avec l’utopie de la révolution permanente – bruyante, lassante et totalitaire – c’était renouer avec le raffinement de ces consciences qui avaient admis, et permis avec sérénité, que le temps passe. Pour autant, il ne s’agissait pas de tomber dans une morbide nostalgie, mais d’admettre que se contenter de dresser pour seul critère d’action et de sélection une carte des nouveautés techniques d’aujourd’hui, c’est se condamner à n’avoir que des vieilleries à proposer demain. La nécessité de renouveau n’a jamais été de l’ordre d’un quelconque matérialisme historique, révélé à un commando de héros prenant sur eux, dans l’abnégation, d’en apporter la bonne nouvelle à l’humanité embourgeoisée : elle est purement et simplement de l’ordre de l’esthétique elle-même, car il est quotidiennement indispensable de redynamiser la conscience du beau par la surprise de ce qui eût dû ne l’être pas, et aucune école, fût-ce celle de Darmstadt, n’a le monopole de cette constante reconversion. Que notre émotion s’use, c’est là une fatalité dont nous n’avons aucune raison de tirer orgueil : on doit bien constater que ce qui était nouveau hier est souvent dépassé aujourd’hui, mais il n’y a guère de sens à se réjouir d’un fait inéluctable, ni à le précipiter.
C’est parfois en tâtonnant, en explorant quelque ancienne voie sans systématisme univoque, qu’on avance le plus loin. Il semblait de plus en plus évident que ce serait en évitant de vouloir changer tout à chaque instant qu’il deviendrait possible de proposer quelque chose de vraiment indispensable : se laisser conduire par une nécessité esthétique, dans une voie de synthèse et de revalorisation des acquis. C’était bien ce que la plupart des compositeurs étaient en train de tenter. Pendant ce temps là , les musicographes allaient-ils poursuivre une théorie ramenant le principal miracle de notre Histoire (son foisonnement et sa liberté potentielle) à une résistance à la facilité – cette éthique de l’effort ! – et consacrant, avec les moyens les plus sophistiqués, les arguties les plus brillantes et l’acuité la plus vive, l’écrasement définitif de l’esprit par la matière ? Là où l’on se targuait de ne pas sombrer dans le violent matérialisme du commerce, nierait-on encore avec la plus énergique intransigeance toute pertinence aux questions sur la musique dépassant sa plus immédiate réalité ? N’y avait-il pas suffisamment de signes qu’il fallait chercher ailleurs que dans la prétention à la modernité technique les critères opérants du jugement esthétique ?
On l’aura compris, pendant longtemps je n’ai plus focalisé mon attention sur le concept de modernité : j’avais décidé, début 90, de le considérer comme non pertinent en regard de mes aptitudes personnelles – orientées ailleurs –, et globalement inopérant dans un monde où tout se proclame nouveau sans parvenir à surprendre.
Puis je suis arrivé à un moment dans mon travail où, disposant désormais d’un outillage personnel plus ou moins adapté, la question de ma propre situation dans l’histoire semblait pouvoir à nouveau être posée utilement. Je me suis ainsi retrouvé face à la difficulté de concevoir la modernité. Je n’ai jamais cru au concept mou et dépressif de post-modernité. Ca ne vaut même pas la peine d’en parler. C’est une invention de journaliste, en quelque sorte : d’une part, littéralement, il n’y a pas d’acte écrit qui puisse se penser hors de l’Histoire. En ce sens, un écrit post-moderne ne pourrait être qu’un non-écrit. D’autre part, la modernité ne se réduit manifestement pas à une certaine manière de faire du vieux neuf – qu’on a pu appeler avant-gardisme. Rien ne nous empêche d’inventer une nouvelle manière de faire du vrai neuf. Or, si on y arrivait vraiment – il n’y a aucune raison sérieuse de penser que ce soit hors de notre portée –, ça n’aurait aucun sens de nommer cela autrement que modernité.
Modernité : un concept aujourd’hui délicat
Le nombre de termes un tant soit peu appropriés qui tentent de situer la musique d’aujourd’hui par rapport à celle d’hier est assez vertigineux. La discussion est sans fin, parce qu’aucun des concepts n’est défini dans un champ neutre. Le choix du vocable est donc toujours coloré pas des conceptions d’ordre culturel, historique, idéologique ou sociologique. Il suffit pour s’en convaincre de remarquer combien chacun des termes souvent évoqués se comprend surtout par ce à quoi il s’oppose.
- Nouveau s’oppose à vieux.
- Avant-garde s’oppose à académisme.
- Actuel s’oppose à dépassé.
- Présent s’oppose à passé.
- Contemporain s’oppose, bizarrement, à décalé (et réclame en principe qu’on définisse contemporain à quoi : car sans autre précision, il semble indiquer que la seule période à laquelle il vaille d’être contemporain soit la présente et réclame ainsi une forme d’adhésion : contemporain à nous). Entre-temps, le terme lui-même est profondément daté, par le fait qu’il se signale comme le lieu d’une rupture située dans le temps. Aujourd’hui, contemporain, en art, veut pratiquement dire « d’il y a une cinquantaine d’années ». De la même manière que Ars Nova signifie « art d’il y a huit siècles ».
Dans un premier temps, donc, avant de considérer, si possible, ce que pourrait être concrètement une modernité d’aujourd’hui, nous tenterons de définir comment le concept s’articule dans notre expérience.
Essayons de comprendre ce que nous voulons dire lorsque nous parlons de modernité. Étymologiquement (d’après le Dictionnaire Historique, Alain Rey, Robert), le mot vient de modernus (récent, actuel). Plus tard, vers 1690, il qualifie un art ou une science dans l’état auquel l’ont porté les dernières découvertes. En relation avec la spécialisation vestimentaire, il signifie ensuite à la page. Depuis 1906, dans les domaines pédagogiques initialement, il s’oppose à classique.
Moderne renvoi donc à quelque chose de récent, technologiquement avancé, à la page et non classique. Ces significations ont-elles une pertinence suffisamment univoque pour être conceptuellement opérantes ?
- Récent. C’est apparemment le plus facile (il suffit de connaître la date), mais aussi le plus problématique. Car selon les autres faisceaux de sens de moderne, certaines choses ont un pouvoir de modernité très étendu dans le temps. Par certains aspects, Webern est encore moderne aujourd’hui (70 ans après). Lorsque l’avant-garde des années ’50 a redécouvert les chromatismes de Gesualdo (1560-1613), elle jubilait (même si en son temps, où la modernité n’était pas recherchée comme une fin en soi, celui-ci était plutôt considéré comme curieux). A l’opposé, nous connaissons tous des pièces récentes qui ne sont pas modernes (au sens ou nous l’entendons).
- A la pointe de la technologie. C’est un point important, mais est-ce que cela a une signification univoque en art ? A quel aspect de la technologie nos sens et notre intellect vont-ils s’attacher pour juger de la modernité d’une œuvre. Au sens de l’harmonie tonale, par exemple, Rachmaninov va plus loin (en tout cas dans ses pièces du début du XXe) que ses prédécesseurs, mais ce n’est pas cela qui a pu le faire paraître moderne au goût de ses contemporains, car ce n’était plus cet aspect technique qui intéressait encore les modernes de l’époque. Dans le domaine de la forme organique, Sibelius a proposé des solutions tout à fait originales, mais il a lui même fini par se décider à cesser de composer, conscient que ses contemporains attendaient autre chose que lui-même n’était pas disposé – ou apte – à élaborer. En revanche, Busoni a proposé (ou simplement imaginé) en vrac vers 1907 toutes les innovations qui allaient marquer la première moitié du XXe siècle (abandon des seuls modes majeurs et mineurs au profit de modes inventés, le recours à des systèmes nouveaux issus du chromatisme, l’ouverture de la lutherie à des sons inconnus, notamment électriques… mais aussi un avant-gardisme radical, l’étude et l’utilisation des folklores, la revitalisation des formes classiques,…). Or, très honnêtement, que peut-on penser aujourd’hui de sa musique ? Pouvons-nous dire si elle a vraiment été moderne ?
- A la page. Nous voici dans le domaine du goût, donc du style. Certaines choses sonnent à la page, d’autres pas, sans qu’on puisse définir de différence marquée en ce qui concerne les dates de compositions ou les techniques utilisées. En 1930, Webern sonne plus moderne, plus à la page, que Schoenberg. C’est indiscutable, et à l’époque cela semblait indémontrable (aujourd’hui on voit mieux les différences de phraséologie, de structuration, etc). Actuellement, certains compositeurs plus ou moins spectraux semblent plus in que d’autres, même si tous se préoccupent d’immédiateté acoustique nourrie par les découvertes récentes dans le domaine du timbre.
- Non classique. D’abord, que veut dire classique ? Initialement : « de première classe ». Ca n’aurait aucun sens de se réclamer comme « pas de première classe », si ce n’est politiquement (pour opposer le populaire de gauche à l’élite). Par la suite : « qui fait autorité ; considéré comme modèle ; digne d’être étudié ». Sous la plume de Voltaire et de l’Encyclopédie, le mot qualifie des auteurs qui, par opposition à ceux qui les précédaient (baroques), ont élaboré un art de mesure, de raison, de respect des anciens. C’est cette notion de respect de la tradition et des modèles qui sous-tend les usages postérieurs du mot : au XIXe s. « (péjorativement) ce qui ne s’écarte pas des règles établies », passant de «qui fait autorité » à « ordinaire, normal ».
Comme on le voit, classique est une notion ambiguë : elle signifie, d’une part, « de première classe, qui fait autorité, digne (et habité) de respect, considéré comme modèle », mais d’autre part « qui ne s’écarte pas des règles établies, ordinaire, normal » (se rapprochant ainsi de académique). L’évolution sémantique du mot classique nous renseigne donc elle même sur l’évolution du mythe de la modernité.
Toutefois, en cherchant à définir le concept de modernité par rapport au classicisme, nous nous mettons nous-mêmes dans un curieux dilemme : aux yeux de tous, nous (musiciens du xxe siècle pratiquant la musique écrite de tradition savante) opérons dans une démarche classique. A l’heure où les musiques classiques se sont vues profondément marginalisées dans les habitudes du public, nous sommes dans cette curieuse situation où nous continuons de vouloir penser la modernité alors que pratiquement personne ne s’attend à ce qu’elle émane de nous (c’est-à-dire du lieu où nous nous situons). Cette visée en surplomb nous renseigne sur un des problèmes stratégiques auxquels un musicien contemporain est confronté : cherchons-nous la modernité à l’intérieur d’un art foncièrement classique (dans une sorte de processus dialectique devant mener à une meilleure vérité de l’art d’élite) ou croyons-nous fermement qu’il n’y a au départ qu’une tradition longuement établie, et par l’acquisition d’un métier, qu’une modernité peut-être pensée avec toute la rigueur nécessaire jusqu’à ses conséquences les plus révolutionnaires (avons-nous, en ce sens, une mission qui consisterait à informer les autres strates de notre art, sur ce que nous saurions de plus, ou d’autre, que leurs acteurs, en conséquence de notre formation et/ou de notre questionnement suivi )? Cette question, en apparence périphérique, est souvent au centre des débat sur la modernité : voulons-nous un jour faire autorité, ou renonçons-nous à une démarche par laquelle l’autorité se fonde (et dès lors, qu’est-ce qui fonde l’autorité ? Ou croit-on pouvoir vouloir renoncer à tout mécanisme de fondement de l’autorité – c’est-à-dire d’établissement de l’Histoire ? Manifestement, ce n’est pas ce que les grands avant-gardistes de Darmstadt avaient en tête…).
Quoi qu’il en soit, nous avons pu voir le glissement progressif du sens de moderne, et l’ambiguïté des critères qui le caractérisent. C’est assez logique pour un concept qui définit un rapport au passé, forcément changeant. Il semble donc qu’il n’y ait pas d’objectivité de la modernité.
S’il en est ainsi, et puisque les époques successives continuent de reconnaître leurs propres modernités changeantes, c’est que la modernité, loin donc de constituer une démarche objectivable dans ses tenants et ses aboutissants, ne peut être comprise que comme une attitude. Serait donc moderne ce qui adopte une certaine attitude qui, justement à ce moment-là (ni avant, ni après) paraît telle aux observateurs avertis (ou supposés tels).
Si on réévalue à cette constatation les sens du mot moderne, on peut poser que la modernité serait une attitude contre l’autorité des modèles, fondée (plus ou moins délibérément) sur les dernières découvertes, de manière à produire quelque chose susceptible de constituer une mode (l’équivalent artistique de la conviction). Une attitude qui remet en question l’autorité par la science en vue d’une nouvelle conviction, c’est ce qu’on appelle un attitude critique.
La modernité, ce serait donc une attitude critique à l’égard des modèles, c’est-à-dire des conventions qu’ils représentent, des habitudes qu’ils ont installées et de l’autorité que cela leur confère.
Modernité après l’avant-garde
Si cette définition assez décevante de la modernité est bien la seule chose que nous puissions avancer avec quelque sûreté, il en découle une conséquence évidente : être moderne nécessité d’identifier des modèles et des conventions à remettre en question. Cependant, après des décennies d’avant-gardisme, il est devenu parfois difficile ne fut-ce que de se reconnaître un modèle, car, comme je l’écrivais plus haut, comment rompre avec une rupture ? S’agit-il d’en finir avec l’idée de rupture, de trouver un champ encore inexploité de ruptures potentielles ou de tenter d’élaborer une synthèse entre ce qui rompt et ce qui est rompu ?
a. lecture marxienne d’une révolution
Ca y est : le terme synthèse a été lâché. N’y a-t-il pas parfois quelque nécessité à reconstruire autrement ce que la modernité a destitué ? Par exemple, chacun sait qu’il n’est pas possible de penser l’art durablement sans se référer, même tacitement, à des notions comme le plaisir où l’émotion. (On peut évidemment prétendre que l’art est mort, que l’œuvre n’est qu’un concept bourgeois, que l’artiste est plus agi qu’acteur…et le tour est joué : on n’a plus alors à s’intéresser au sujet dont on s’était doté, et il ne reste qu’à se préoccuper des avatars de la destitution de ce comportement anachronique – démarche éventuellement appréciée des purs commentateurs, puisqu’ils se retrouvent ainsi investi du pouvoir absolu sur ce qu’ils ne possèdent pas. Disons que ce n’est pas notre démarche, et continuons). Pourtant ces notions ont été considérées longtemps, et peut-être à juste titre, comme suspectes. Comment rompre honnêtement avec la virilité et l’apparente bonne santé de ce refus de toute concession, alors même que nous observons que notre intérêt propre à l’égard de notre champ d’activité s’étiole en dehors du désir de jouir et de ressentir (que dire alors d’un public qui ne partage peut-être même pas l’extase de la virtuosité, ou l’illumination de l’idée) ? Là est le principal problème sans doute : il n’y a aucun mérite intrinsèque à résister contre la rupture. Et pourtant, si la modernité doit être envisagée comme une étape d’un test dialectique de vérité, il y a nécessairement un moment où la chose refusée doit être réintroduite au sein de la chose qui refuse pour produire le statut nouveau de la vérité. En d’autres termes, l’antithèse une fois élaborée doit être à nouveau confrontée à la thèse pour produire la synthèse qui est le but ultime du processus.
C’est un peu marxien comme analyse, dans son aspect matérialisme dialectique élémentaire, mais on voit bien qu’il y a un problème de ce côté : s’il est assez facile de reconnaître une rupture (une antithèse), puisqu’elle comporte les qualités inverses de la situation initiale (la thèse), quels sont les critères de validation d’une reconstruction (la synthèse) ?
Hors du domaine de l’art, on a pu observer que ce n’était pas si simple : en URSS, par exemple, s’il s’est avéré assez excitant d’installer la dictature du prolétariat en réaction contre le régime féodalo-impérial qui précédait, une fois cette étape d’antithèse engagée, en revanche, qui pouvait dire comment adviendrait le grand soir ? : personne semble-t-il, puisque toute la dynamique s’est retrouvée bloquée par les garants de la révolution…ceux qui ont systématiquement interdit toute aspiration moderne (synthétique) qui équivalait pour eux à revenir en arrière (et à remettre en question la logique de rupture sur laquelle ils avaient assis leur pouvoir). Nous avons aussi nos critiques staliniens, et s’il est facile d’en rire, il n’est pas si simple de les faire taire en nous-mêmes.
La question la plus grave qui émane des petites constatations qui précèdent, c’est que si aucune synthèse ne peut jamais émerger d’une rupture consommée, alors il y a une certaine folie à n’envisager la modernité que sous l’angle de la rupture : jusqu’où peut-on utilement scier la branche sur laquelle on est assis ? Il m’a d’emblée semblé qu’on arrivait au terme de cette logique cumulative. Trouver les voies de la synthèse devenait une nécessité absolue, tant au plan historique que méthodologique, philosophique ou politique. Sans cela, il n’y a définitivement qu’une solution : envisager l’ensemble forcément fini des ruptures possibles et les consommer une par une… ce qui suppose que la modernité (le progrès) au sens où l’entend l’avant-gardisme est la seule fonction de l’art. Refuser d’être berné par les faux-semblants de l’art, traquer, une par une, les illusions de la représentation, resterait ainsi, encore et toujours, la seule attitude digne de respect,… jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à berner. Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’illusion, et donc plus d’imaginaire (c’est un raccourci vertigineux, je l’admets, mais l’imaginaire me semble pouvoir se définir ainsi : une faculté qui nous élève en se laissant délibérément et momentanément berner par des images de pure convention afin d’étudier les relations qui les animent). Vouloir cela équivaut ainsi à vouloir la fin de l’humanité en même temps que la fin de l’art.
Aujourd’hui ça peut paraître naïf, mais il m’a paru d’abord que la seule modernité constructive était d’adopter une attitude critique à l’égard des modèles établis dans ma jeunesse : c’est à dire à l’égard de l’avant-gardisme. Si l’on veut, il me semblait indispensable de savoir s’il était possible d’inaugurer une attitude critique qui en ait fini avec l’idéologie de la rupture, sans revenir pour autant à l’angélisme qui l’avait précédé et qui avait produit ce que l’on sait (en vrac : Wagner et Poulenc, le colonialisme, les séductions fascistes et le mercantilisme), avec quoi il avait été juste de rompre.
b. L’hors-champ et l’en-champ du contemporain
Ce qui est naïf, veux-je dire, ce n’est pas d’adopter une attitude critique, mais c’est de choisir nécessairement comme modèle à interroger, l’avant-gardisme des années ’50-70. C’est d’avoir considéré a priori que le point d’ancrage de ma pratique se situait justement là . C’est de ne pas avoir mis en question, du moins du moment que je me mettais à écrire, ce qui faisait que pour moi, sans aucun doute, c’était ceux-là qui représentaient l’autorité.
Qu’est-ce qui pour nous est de l’ordre de l’autorité à critiquer ou de ce qui nous donne l’autorité pour critiquer ? Du moment qu’on critique, est-on d’office auto-proclamé habilité à le faire, ou gardons-nous de préférence une distance qui est ce lieu d’où l’on critique. Je veux dire : critiquons-nous uniquement en tant que musiciens classiques, parce que dans certains domaines de la création, nous avons une formation de longue date qui nous fonde à remettre les choses en question avec une certaine légitimité, mais en se gardant d’intervenir dans des domaines qui ne sont pas les nôtres ; ou allons-nous jusqu’au bout de la mise en question, nous risquant aussi hors des cloisons qui précisément enserrent confortablement notre formation, et donc notre pratique autorisée, jusqu’à une attitude critique qui s’autoproclamerait universelle (s’autoproclamerait, puisqu’elle jugerait de ce qu’elle n’a pas appris à juger) ? En d’autres termes encore : pouvons-nous rester dans le champ strict du contemporain. Et si nous le faisons, pouvons-nous encore prétendre à la modernité ?
N’y a-t-il pas justement dans tout cloisonnement, dans ce communautarisme qui gagne tout, la barrière infranchissable contre toute vérité ? N’y a-t-il pas le refus de tout test de validité, de tout jugement, en tant qu’un jugement est une confrontation à l’universel ?
Devrions-nous dire : « on fait de la musique contemporaine parce que c’est notre truc à nous ; on est des musiciens blancs, européens, de culture classique, de goûts un peu intellectuels, d’un niveau technique supérieur à la moyenne et privilégiant la musique écrite parce qu’on sait la lire. Le plus souvent possible nous organisons des manifestations, que nous appelons concert, où nous nous retrouvons entre nous pour juger de ce qui est bien. C’est notre droit communautaire. On ne s’occupe pas de ce que font les autres. On ne fait de mal à personne et on se marre bien. » ?
Ou bien avons-nous encore l’ambition de l’universel ?… même si les seuls qui semblent encore y croire aveuglément sont ces staliniens du post-webernisme dont nous parlions tout-à -l’heure, groupe de pression constitué désormais d’une trentaine de personnes semble-t-il, ce qui – même si l’on ne confond pas l’ambition abstraite de l’Universel avec la loi concrète du grand nombre – constitue en soi un fait alarmant concernant le réalisme de leur projet. Du moins selon leurs critères…
Les lois de nos pères
Il nous faudrait donc trouver des critères selon lesquels nous pourrions, compte tenu de la place que nous occupons dans la réalité artistique d’aujourd’hui, proposer quelque chose de moderne qui tenterait d’avoir valeur d’universalité. On est bien d’accord que ce serait renouer avec l’utopie ou plutôt, dans une démarche préalable, avec l’idée de l’utopie. Est-ce réaliste ? Honnêtement, je n’en sais strictement rien. Serait-ce utile ? Peut-être pas, mais que pouvons-nous envisager d’autre ?
a. qui sont nos pères et quelles sont leurs lois ?
Si c’est cela notre mission, il est indispensable de poser la question de notre héritage. Car, d’une part, ce ne peut être que de là que nous partirons, d’autre part, c’est cela même que nous devons faire fructifier, et donc mettre en question.
Pour ma part, je ne suis plus si sûr que le seul héritage que je puisse me reconnaître se situe dans le domaine de la musique contemporaine. Je veux dire qu’à côté de Boulez, Stockhausen, Berio, Ligeti, Scelsi, Xenakis, Varèse mais aussi Grisey, Cage, Reich, Feldman, Harvey,… il me semble que je ne peux pas penser mon avenir créatif dans le maintien d’une imperméabilité aux influences du jazz, du rock, des musiques électroniques plus ou moins savantes, des expériences multimédias, …, et même, pour le dire simplement, d’une esthétique du fun. Ce que je veux dire c’est que même si je réclame des plaisirs raffinés, même si je sais qu’accepter l’éventualité de l’ennui est un préalable indispensable à l’aventure esthétique, je ne peux pas me résoudre à une routine sérieuse dans laquelle une prétendue rigueur morale serait le gage indispensable de toute qualité. Je ne peux pas me résoudre à ce que la spécificité du domaine où j’agis soit une forme de stoïcisme esthétique dont le symptôme serait la résistance mythique aux dérives du monde extérieur (c’est-à -dire : maintenu artificiellement à l’extérieur).
C’est peut-être ce modèle-là qu’il faut mettre à terre : celui d’un art respectable qui se consommerait avec modération dans la quête perpétuelle d’une profondeur jamais atteinte auparavant. Puisque la seule modernité possible est de poser (comme attitude plus que comme conviction) que rien n’est respectable a priori, peut-être est-il particulièrement nécessaire aujourd’hui de se demander si la musique moderne elle-même est digne du respect que nous lui témoignons. Peut-être, ne peut-elle éventuellement rencontrer un respect a posteriori (le seul défendable) qu’en sortant d’elle-même. Qu’en allant à la rencontre de ce qui se fait dans le monde. Qu’en admettant que la lutte pour le maintien d’un discours utile sur l’Universel de la lettre (l’amour pour la musique écrite et/ou pré-conçue) réclame en des temps d’ignorance (ignorance dont nous sommes également les enfants) d’entendre à la fois ce qui manque et ce qui éclot dans l’absence de la lettre.
b. quels sont nos manques ?
Mais au fond, pour entreprendre cette démarche sans choir dans la démagogie, la vanité ou la prétention, qu’aurions-nous comme garde-fou ? Qu’est-ce qui pourrait nous guider dans cette aventure où, tel le bernard-l’ermite, nous sortirions de notre coquille pour en investir une plus grande ?
Peut-être n’y a-t-il qu’un seul guide, ô combien peu fiable : la part de notre désir et de notre frustration, son envers, qui réclame un changement des lois. L’identification des conventions qui nous empêchent d’avancer vers notre accomplissement et des moyens que nous avons, ou que nous pourrions avoir, pour les supprimer. Et même si ces conventions ont été modernes, ont remplacé quelque chose de pire, la conviction que nous ne leur devons rien.
Le respect des convenances s’articule autour du besoin de prestige social. Le moteur de la modernité, c’est le refus de passer à côté du bonheur à cause de lois que plus rien ne justifie. Etre convenable ou être moderne : il semble qu’il n’y ait toujours pas de solution médiane.
Le zappeur et l’ennui : quid des formes de demain ?
De quoi le monde me donne-t-il l’exemple ? Telle est la question qui ouvre mes yeux et mes oreilles lorsque je refuse d’être défini par les seuls acquis de mon histoire personnelle. Telle est la question qui m’excite lorsque j’interroge mon utilité dans ce monde en tant que compositeur contemporain.
a. sensibilité contemporaine (?)
Sans se risquer à de grandes considérations, nécessitant sans doute des études sociologiques pour lesquelles nous n’avons ni le temps ni la compétence, que pouvons-nous dire de la sensibilité esthétique telle qu’elle se développe aujourd’hui dans notre contexte socioculturel européen ? Impossible de faire dans le détail : juste quelques pistes, quelques intuitions, quelques flashes (des clichés, sans doute), une liste désordonnées des ingrédients qui me semblent inhérents à mon époque et à la manière dont mes contemporains sont disposés à l’égard des objets, des formes, du temps et de l’espace (les fondements de la sensibilité), une image un peu floue de l’univers dans lequel je produis.
Grandes tendances : recyclage-collage, mondialisme et éclectisme, capacité immense de discrimination entre les sons ou les images, mais absence quasi totale d’oreille harmonique ou d’œil analytique, inconscience consécutive de la forme, désintérêt général pour l’ordre et la structuration, inaptitude à la fixation mais stupéfiante rapidité d’adaptation, spiritualité hallucinatoire et goût marqué pour le planant-pulsé, retours stylistiques au passé même dans des pratiques traditionnellement peu enclines à penser leur historicité, interrogation permanente du mouvement et fascination pour la vitesse en dehors de toute considération pour le dynamisme ou le progrès, positivation de la confusion des dimensions (verticale, horizontale ou oblique), disposition consensuelle au non engagement, fascination sécuritaire pour le bio-l’allégé-l’authentique-le cocoon, communication à outrance dans l’indifférence au message, obsession de l’apparence et recherche désespérée d’une Nature,… Tout cela prescrit en définitive un espace-temps assez curieux : violemment lent, bruyamment doux, religieusement physique, statiquement versatile, calmement défoncé, froidement caressant; en bref, une impérieuse immédiateté non dénuée d’un mysticisme un peu fumeux, la plupart du temps ritualisé mais non conceptualisé. En ce qui concerne l’attitude d’écoute, aucun temps mort (ou en tout cas considéré comme tel, dans une logique qui peut parfois échapper à un auditeur formé au classique) n’est concédé et il y a toujours un autre disque, une autre salle, une autre émission ou une autre station pour proposer des objets plus captivants. Les modes de production – comme l’échantillonnage ou le copier-coller – sont opportunistes ; les modes de diffusion aussi. Le temps est hyper-rapide mais cyclique. L’espace est toujours trop petit. Tous les objets sont beaux si « quelque part, je le sens comme ça ». La forme est une sorte d’ésotérisme énigmatique. De toute façon rien n’est engagé dans une historicité. Comparer est une injure.
Tout cela constitue bien sûr d’avantage le rapport de mes propres fantasmes que la description d’une réalité objective : comment et à quoi bon s’en garder, de toute façon ? Mais il me semble que s’en dégagent au moins quelques aspects intéressants. Le point le plus remarquable de la sensibilité esthétique actuelle serait peut-être une immense ouverture à un espace-temps non anecdotique mais obligatoirement captivant, non directionnel mais versatile, chaotique, non systématique mais non hasardeux, que nous pourrions qualifier de purement timbral. En ce sens, nous pourrions dire que nous sommes à la pointe du progrès, puisque les développements les plus insignes de notre pratique contemporaine s’inscrivent justement dans ce domaine : ce n’est évidemment pas un hasard. Dès lors, bien que ne sachant pas trop à qui nous nous adressons, et avec quelle mission, nous avons ainsi le sentiment d’être en phase avec l’évolution du monde où nous sommes retranchés. Mais il ne faut pas négliger une autre tendance observable, plus alarmante peut-être, puisqu’elle met en cause, à mon sens, les conditions nécessaires au fonctionnement de toute démarche artistique (après quoi chacun est libre de considérer que cette démarche elle-même est un anachronisme) : la propension irrésistible au zapping.
b. communication zéro
Tout le monde zappe. Pas le temps d’approfondir : on passe à autre chose, et la plupart du temps à juste titre puisque plus personne ne parle. On se souvient malheureusement de tous ces horripilants débats télévisés où les présentateurs, obsédés par la crainte que les spectateurs ne changent de chaîne, organisent eux-mêmes leur zapping interne, posant leurs questions à toute allure et ne laissant pas le temps à leurs invités d’articuler une réponse cohérente et nuancée. Il faut aller vite, ne pas risquer d’ennuyer, réduire les avis à des caricatures d’opinion, et donner l’impression d’un événement intellectuel en brocardant tyranniquement les caricatures ainsi produites. C’est lamentable, là aussi il faut bien zapper.
Cela semble légitime : pourquoi s’imposer l’ennui ? Si une chose n’est pas convaincante, il y en a dix derrière qui ne demandent qu’à être appréciées, et la société de consommation y pourvoit. En gagnant un peu de temps sur ce qui ne se donne pas immédiatement, on a peut-être quelque chance de débusquer dans ce fatras d’informations la perle qui animera notre vie…
Mais si je considère ce qui m’a vraiment animé… Qu’aurais-je connu si j’avais changé de sujet chaque fois que je n’étais pas convaincu d’emblée ? Quelques unes de mes plus grandes émotions ne m’auraient-elles pas échappé si je n’avais pas été amené à insister ? J’y étais poussé inéluctablement : quelque chose s’y exprimait que je voulais pénétrer, même si c’était un peu difficile, même si certains moments étaient moins passionnants que d’autres. Je prenais patience pour éprouver plus fort, pour connaître mieux et finalement, pour comprendre, parce que ça me faisait rêver et que je voulais communiquer avec ce qui m’était proposé. Je suis d’une génération du désir et du savoir. Je sais que ma liberté en dépend : être capable d’écouter sans nécessairement attendre de satisfaction immédiate. J’ai mes frustrations sans doute – plus longues que si je zappais dès les premiers signes apparents de fléchissements – mais j’ai aussi des plaisirs plus puissants, moins prévisibles. C’est cette question là que je me sens plus habilité que d’autres à poser à mes contemporains, une question qui s’articule de manière totalement neuve avec la sensibilité moderne : que peut-on espérer des objets qui s’offrent à nous si l’on n’est pas prêt à se mesurer à l’éventualité de l’ennui ? Quelle forme peut se construire hors de tout sacrifice au passage du temps ? Qu’est-ce qui peut s’exprimer valablement dans l’absolue immédiateté ?
Un concept vient d’être évoqué qu’il convient de désamorcer au plus vite: expression. On est ici sur un terrain – ô combien ! – mouvant. Expressivité ! Ne sait-on pas assez que la prétendue expressivité n’est qu’une construction culturelle – et de surcroît bourgeoise – extérieure à la nature matérielle et formelle du phénomène musical, dont aucune règle d’universalité n’a pu être observée, que ce soit dans l’histoire ou dans l’étude anthropologique, et que se référer à cette vieille putain est une injure rédhibitoire à tout ce qu’il y a d’élevé, d’abstrait et donc de valable en art ? Ignore-t-on qu’il n’y a aucune essence de l’émotion qui puisse s’avérer consubstantielle à l’essence musicale, à supposer que celle-ci ne soit pas tout bonnement précédée par son existence, et que dans ces conditions, même pour rire, suggérer s’en préoccuper est le cachet de la ringardise la plus pure ? Y a-t-il encore quelqu’un pour nier que tout ce qu’on pourra en dire n’est que conjecture, bigoterie ou mystification, qu’il n’y a plus lieu de fonder la moindre réflexion esthétique sur ce concept et qu’il convient sur-le-champ de faire confiance aux spécialistes en admettant une fois pour toute que ces fadaises hystériques ne sont bonnes que pour les consommateurs abrutis et leurs exploiteurs ?
La chose semble jugée, mais cet anathème règle-t-il définitivement la question ? Certes, il faudrait faire le tri entre la prétendue expression du compositeur, la, ou les, nature(s) de l’émotion artistique, la qualité matérielle d’un objet musical, les raisons des justes remises en question de la notion de transcendance… Certes, il faudrait être plus philosophique, mais n’expérimentons-nous pas quotidiennement que la musique reste un ailleurs indicible duquel il s’agit précisément de parler ? L’expressivité est sans doute un terme mal choisi, peut-être faudrait il parler d’impressivité ; car le plus important n’est pas tant ce que la musique nous dit, mais ce qu’elle nous invite à dire. N’est-ce pas aussi pour nourrir des discours riches que nous élaborons des pensées complexes ? Si la musique était seulement abstraite, combien d’entre nous s’y adonneraient ? Qui renoncerait avec le sourire à son incarnation dans le monde du sonore ? Doit-on suivre le modèle beethovenien jusqu’à s’imposer les mêmes coups du destin ?
Une idée qui nous parle de son incarnation, une incarnation qui cherche à s’élever au rang de pensée, que peut-il y avoir de plus humain ? Comment pourrait-on oublier que cette incarnation même est l’exercice permanent de notre propre condition. Il n’y a pas de théorie qui puisse prétendre au statut de vérité hors de toute vérifiabilité matérielle. En musique, où les formes ne sont heureusement pas falsifiables, le test expérimental ne peut se rapporter qu’à cette part de communication instantanée qu’on nomme, faute de mieux, expression. Aussi illusoire, aussi éphémère, aussi imprécis soit-il, c’est le seul test de vérité dont nous disposerons jamais. Le déplorer est une chose, mais le nier, c’est se couper du monde.
En conclusion
Croyez-moi, je sais que les réflexions qui précèdent ne sont qu’apparemment ordonnées, qu’elles ne semblent rationnelles que par défaut. Ce qui s’y exprime, c’est moins un cheminement logique, que le récit d’une sensibilité particulière, en une certaine époque, sous un angle déterminé. Dans mon domaine on ne peut faire abstraction des générations et des idées reçues. Pour les aînés tout paraîtra insensé dans ma manière d’aborder les choses : jetées aux oubliettes, leurs belles valeurs ! Pour les plus jeunes, je l’espère du moins, la question de l’appartenance au monde se pose déjà en de tout autres termes.
Rompre avec la rupture par principe, résister aux tentations passéistes, interroger la possibilité des formes, restaurer une dignité de l’émotion : ce sont nos tâches. Nous tentons de les mener à bien, en espérant qu’émergeront çà et là , peut-être à notre insu, quelques réussites qui transcenderont leur objet.
J’aime à être d’une génération intermédiaire. Je revendique le droit de me considérer comme un médiateur. Je crois en la fécondité de l’impur. Et si je m’y adonne, c’est que je me refuse à être le dernier descendant d’une lignée aristocratique épuisée par une consanguinité perverse.
La dernière déchéance serait d’espérer un refuge : plonger dans la crasse pour en extirper les plus jeunes pousses, souiller ses mains au premier mortier, comprendre l’étranger, le barbare. C’est ainsi que recommence perpétuellement toute civilisation.